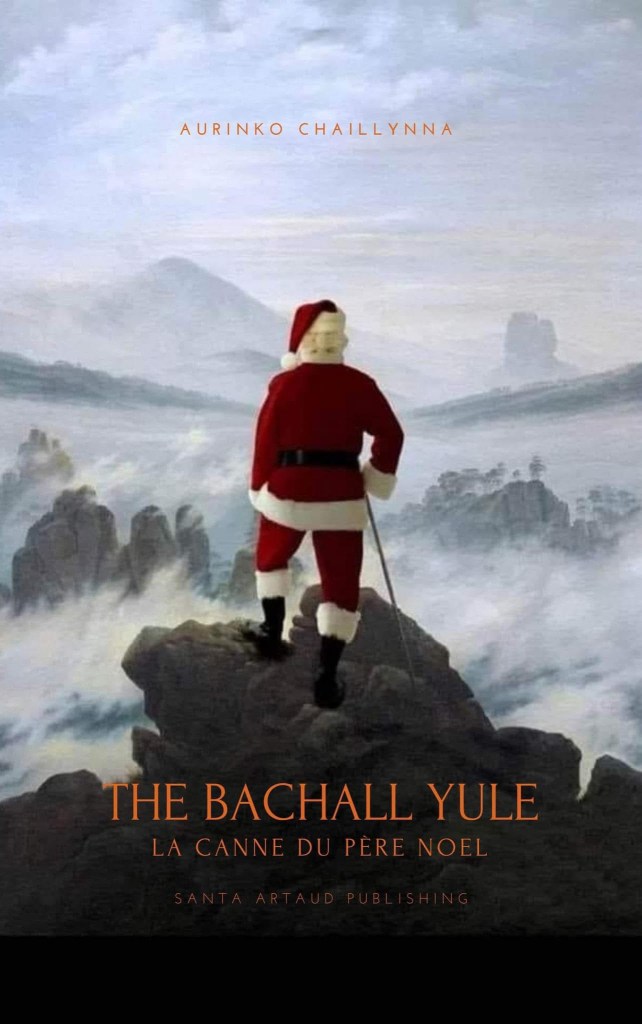Il y a quelques jours, en longeant les vitrines des Galeries Lafayette, la foule avançait par à-coups, compacte, haletante, les bras chargés de paquets, les visages tendus par l’urgence d’en finir. On se frôlait, on se heurtait, on s’excusait à peine. Noël approchait, et avec lui cette fièvre particulière qui transforme les rues en couloirs de transit, les corps en marchandises pressées.
À mesure que je marchais, une image s’est imposée à moi : Artaud et Prével, quelque part dans la foule, légèrement en retrait, à distance de ce spectacle. Ils regardaient. Artaud surtout. Il observait cette humanité en mouvement comme on observe un théâtre qui aurait perdu son sens. Ses yeux suivaient les gestes, les mains avides, les visages vides, et je l’entendais presque respirer plus fort, comme si quelque chose, en lui, s’étranglait.
Puis sa voix surgissait, sèche, incrédule, traversant le vacarme : « Regardez-moi ces gens. Qu’est-ce que c’est ça ? À quoi ça sert-il qu’il y ait autant d’hommes sur la terre ? Vous les voyez se démener, se précipiter. On croirait qu’ils vont faire quelque chose d’intéressant. Mais pensez-vous. Ils ne pensent qu’à gagner de l’argent, à bouffer, à baiser, c’est tout. À quoi sert-il leur vie. » (En compagnie d’Antonin Artaud, 141)
Quand Paris invente la marchandise-roi

La seconde moitié du XIXᵉ siècle, dans un contexte de prospérité économique et de profondes transformations urbaines — au premier rang desquelles le Paris haussmannien — voit naître les premiers grands magasins, appelés à révolutionner durablement le commerce et la culture matérielle. Le Bon Marché, fondé par Aristide Boucicaut en 1852, fait figure de pionnier : souvent considéré comme le premier grand magasin moderne au monde, il constitue une véritable ville marchande dans la ville, avec plusieurs centaines d’employés et des centaines de rayons. Boucicaut y introduit des innovations décisives : prix fixes, possibilité d’échange ou de remboursement, ventes à bas prix, puis soldes saisonnières.
Ce modèle est rapidement imité : Au Printemps (1865), La Samaritaine (1870), puis les Galeries Lafayette, fondées en 1893, prolongent et amplifient cette révolution commerciale. Situés sur les grands boulevards haussmanniens — artères larges, facilement accessibles, proches des gares et des grands flux de circulation — ces établissements font de Paris l’une des capitales du capitalisme naissant. Les Galeries Lafayette, conçues à l’origine comme un bazar aux accents orientalistes évoquant l’imaginaire des Mille et Une Nuits, illustrent cette hybridation entre commerce, spectacle et rêve.
Tout est alors pensé pour retenir le client le plus longtemps possible et stimuler la consommation. Certains établissements, comme les magasins Dufayel, destinés à attirer les classes populaires, proposent des dispositifs spectaculaires : aquarium, volière, scène de théâtre, voire projections cinématographiques, à peine après l’invention du cinéma par les frères Lumière. Ces vastes temples de la consommation se distinguent par leur architecture monumentale et la mise en scène théâtrale des marchandises, associées à des méthodes commerciales inédites — prix fixes, soldes, catalogues de vente par correspondance, publicité de masse — qui incarnent la modernité face aux petites boutiques artisanales jugées obsolètes. Grâce à la production industrielle et aux économies d’échelle, les grands magasins diffusent en masse des objets de mode et d’ameublement standardisés, contribuant à l’uniformisation du goût et des intérieurs.
Parallèlement, le foyer se transforme en prolongement direct du marché. La clientèle féminine, cible privilégiée de ces nouveaux bazars, est encouragée à renouveler sans cesse l’agencement domestique au rythme des modes imposées par les vitrines et les catalogues. Émile Zola décrit magistralement cette dynamique dans Au Bonheur des Dames, où les grands magasins apparaissent comme de véritables cathédrales du commerce, « tentation immense » éveillant chez la bourgeoisie montante des désirs toujours renouvelés. Ces lieux attirent une classe sociale en quête d’ascension et d’identité culturelle, tout en faisant pénétrer la logique de la consommation de masse au cœur même de l’intimité domestique.
Le succès des grands magasins repose sur une massification inédite du commerce. Boucicaut et ses concurrents développent une stratégie fondée sur le volume des ventes : encarts publicitaires dans la presse, catalogues diffusés dans toute la France, fin du marchandage, promotions régulières et livraison à domicile. Cette organisation s’appuie sur la fabrication industrielle en série : vêtements, meubles et objets du quotidien sont produits en grande quantité, ce qui permet de réduire les coûts et d’abaisser les prix. Les grands magasins offrent en outre un confort moderne — rayons spécialisés, vendeurs formés, espaces de repos — incitant la bourgeoisie à délaisser les commerces traditionnels au profit de ces établissements capables de tout proposer sous un même toit.
Cette transformation du paysage commercial s’accompagne cependant du déclin progressif des formes artisanales et locales. Dès les années 1880, à Paris, de nombreux magasins de nouveautés et ateliers indépendants disparaissent, incapables de soutenir la concurrence de ces géants de la distribution. Les savoir-faire locaux et la diversité esthétique s’effacent au profit d’une standardisation industrielle croissante ; la créativité artisanale se trouve absorbée par un marché de masse uniformisé. Certes, certaines enseignes tentent de rehausser le niveau artistique de leur production — à l’image des ateliers Primavera (Printemps) ou de La Maîtrise (Galeries Lafayette) dans les années 1910-1920 —, mais, comme le souligne Antonin Artaud, ces efforts bénéficient avant tout à « la haute aristocratie de l’argent qui paye ainsi chèrement le privilège de vivre dans la beauté ».
Du “Grand Magasin éducateur” au “Grand Magasin empoisonneur” : la riposte d’Artaud

Dans le numéro 83 de la revue Demain (janvier-février-mars 1921), le docteur Édouard Toulouse publie un article intitulé Le Grand Magasin éducateur’, dans lequel il défend l’idée que les grands magasins peuvent jouer un rôle de formation culturelle et sociale auprès du public. Antonin Artaud, en désaccord avec cette position, rédige alors un texte en réponse à cet article, intitulé Le Grand Magasin empoisonneur (Œuvre complète tome II) qu’il adresse à l’épouse du medecin. Ce texte, conçu comme une réplique directe, constitue une critique de cette prétendue fonction éducative des grands magasins et marque l’un de ses premiers affrontements explicites avec les discours hygiénistes et progressistes de son époque.
Le grand Magasin éducateur, article du docteur Edouard Toulouse
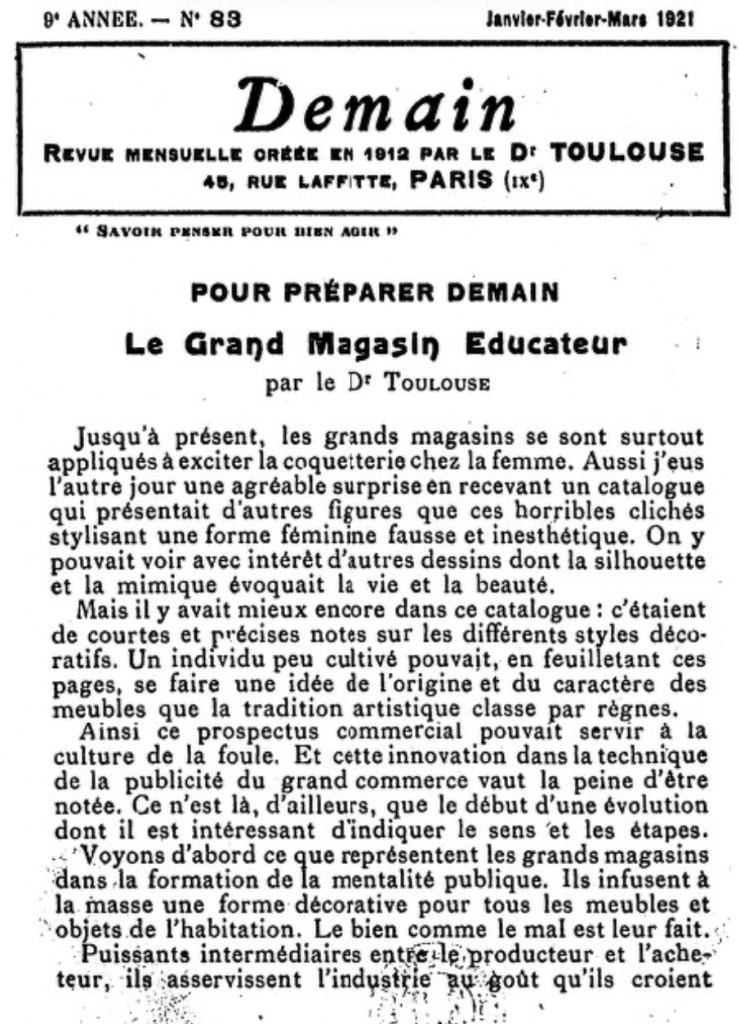
Dans Le Grand Magasin éducateur, le docteur Toulouse rappelle que, jusqu’alors, les grands magasins cherchaient surtout à vendre en multipliant des images de femmes jolies mais artificielles, éloignées de toute vérité esthétique. Il se dit cependant agréablement surpris de recevoir un catalogue différent, proposant des dessins plus justes, plus vivants, et moins stéréotypés.
Ce catalogue ne se contente pas d’illustrations : il présente aussi, de manière simple et accessible, les différents styles de mobilier et leur origine. Ainsi, même une personne peu instruite peut, en feuilletant ces pages, acquérir une première compréhension de l’histoire de l’art décoratif et des caractéristiques des meubles classés par époques et par règnes. Le simple prospectus commercial devient alors un outil de culture populaire.
Le docteur Toulouse souligne que les grands magasins jouent un rôle déterminant dans la formation du goût collectif. Placés entre les fabricants et les acheteurs, ils ont le pouvoir d’orienter, voire de créer les préférences du public. Ils ne se contentent pas de répondre à la demande : bien souvent, ils la façonnent, guidés par des logiques de profit qui peuvent produire aussi bien des effets positifs que des dérives.
C’est ainsi que la France s’est peu à peu trouvée envahie par des meubles imitant maladroitement les styles anciens : copies affaiblies, fabriquées au détriment des petits artisans et souvent moins solides que les productions traditionnelles. Toutefois, Toulouse reconnaît également un progrès : ces grandes enseignes permettent désormais à un public plus large d’accéder à un certain confort et à une forme de luxe autrefois réservée à une minorité.
L’auteur estime dès lors que les artistes et les médecins devraient occuper une place réelle dans la direction des grands magasins, à l’image des scientifiques dans l’industrie. Leur présence garantirait une orientation plus responsable, à la fois sur le plan esthétique et social.
Il observe enfin l’essor des rayons consacrés à l’hygiène et à la santé, où l’on vend des objets destinés à la propreté et aux soins du corps. Si cette mise en scène peut paraître surprenante, elle contribue néanmoins à diffuser des pratiques sanitaires élémentaires, à prévenir certaines maladies et à sensibiliser le public : « L’hygiène aussi devient un département important de ces grandes boutiques. Il n’en est plus qui n’ait aujourd’hui son rayon sanitaire, où de jeunes personnes, costumées en infirmières, offrent aux clients interloqués des brosses à dents pêle-mêle avec les thermomètres et les canules. Et ce rayon, dont la mise en scène fait un peu sourire, n’en joue pas moins un rôle pour la formation de la mentalité collective. Par là le grand magasin peut apprendre la propreté au peuple, lui faire comprendre comment il est possible d’éviter les maladies les plus communes et quels soins il doit apporter à l’entretien quotidien de son corps.»
Mais le docteur Toulouse alerte : si ces initiatives ne sont motivées que par le profit, elles peuvent devenir dangereuses. Un grand magasin pourrait tout aussi bien diffuser des produits nocifs s’il y trouvait un intérêt financier. Là encore, le contrôle et l’intervention des médecins lui semblent indispensables.
Ce mouvement n’en est qu’à ses débuts : il reste fragile et imparfait, mais mérite d’être encouragé. Les grands magasins disposent d’un pouvoir considérable : ils peuvent participer à l’amélioration du goût artistique et de l’hygiène collective, à condition d’être pensés comme des instruments d’éducation populaire, et non comme de simples machines à profit.
Le grand magasin empoisonneur, manuscrit de Antonin Artaud

Dans Le Grand Magasin empoisonneur, Antonin Artaud accuse frontalement les grands magasins d’être largement responsables de l’appauvrissement généralisé du goût en France. Par leurs prix bas, leurs facilités de livraison et leur puissance de diffusion, ils ont imposé à la bourgeoisie comme aux foyers modestes une décoration standardisée et laide : meubles fabriqués en série, imitations grossières des styles anciens, objets sans utilité réelle ni valeur artistique. Ce qui se présente comme un progrès n’est en réalité, pour Artaud, qu’une industrialisation du faux — une première victoire de ce que Deleuze et Guattari nommeront plus tard la production capitaliste de simulacres fonctionnels, où l’objet ne répond plus à un usage vital mais à une logique abstraite de circulation.
Selon Artaud, cette domination commerciale a détruit les petits commerces et les initiatives individuelles, qui constituaient autant de foyers de création personnelle. Là où certaines villes étrangères — Vienne notamment — conservent des intérieurs marqués par une identité, une sensibilité et une âme, le foyer français se voit uniformisé par une indigence décorative qui efface toute singularité. L’habitat cesse d’être le prolongement vivant d’un individu pour devenir un simple point de consommation. En termes deleuzo-guattariens, le logement devient un territoire codé, soumis à des modèles dominants, privé de toute possibilité de reterritorialisation créative.
Artaud reproche au peuple son aveuglement, mais vise avant tout le système qui l’a rendu incapable de distinguer l’utile du faux luxe. Un meuble n’a de sens, selon lui, que par sa fonction ; il ne peut s’en écarter qu’à condition de posséder une véritable valeur artistique. Une simple armoire de bois blanc, répondant à un besoin réel, lui paraît infiniment plus juste que les meubles de série des grands magasins, dont les références stylistiques ne sont que des caricatures vidées de toute nécessité intérieure. Cette exigence rejoint la critique formulée dans L’Anti-Œdipe : le capitalisme produit des objets qui miment le désir tout en le neutralisant, des formes séduisantes qui empêchent toute production désirante authentique.
Cette critique du goût n’est cependant qu’un premier niveau. Dans Pour en finir avec le jugement de Dieu, Artaud élargit radicalement son diagnostic : dans ce contexte le grand magasin ne serait plus seulement un diffuseur de laideur, mais l’un des rouages d’un système global fondé sur la production à tout prix et la substitution du vivant par l’ersatz. Avec ce texte écrit à la fin de sa vie, Artaud, en suivant cette logique, annonçait déjà notre monde actuel : celui du meuble standardisé de style IKEA, de la nourriture synthétique, d’une nature remplacée et du corps réduit à un objet fonctionnel. On ne produit plus pour vivre, on vit pour produire — et pour consommer ce qui n’a plus rien de vivant. Deleuze et Guattari parleront ici d’un monde régi par des machines sociales qui un peu comme dans Matrix branchent directement le corps humain sur des flux de production et de consommation, au détriment de toute intensité vitale.
Les objets comme les aliments deviennent des produits de remplacement, destinés non à nourrir un besoin réel, mais à saturer, à anesthésier. La consommation moderne ne vise pas la satisfaction, mais la satiété — cet état de remplissage qui neutralise le désir, pousse à encore plus de consommation et empêche toute révolte du corps.
Derrière cette production massive, Artaud désigne une logique unique : le profit, indissociable d’une volonté de contrôle. Peu importe aux dirigeants de ces enseignes que leur activité diffuse la laideur, le faux et le substitut à grande échelle ; l’essentiel est que l’homme moderne, de sa naissance à sa mort, baigne dans un univers entièrement fabriqué, prévisible, programmable.
Artaud reconnaît que certains créateurs et décorateurs talentueux peuvent encore concevoir des intérieurs harmonieux et sensibles, mais ces réalisations restent réservées à une élite fortunée, qui paie très cher le privilège d’échapper provisoirement à l’univers du faux. La beauté devient un luxe, tandis que la laideur industrielle est démocratisée. Le capitalisme sait organiser la raréfaction.
Pour Artaud, le grand magasin — incarné symboliquement par Boucicaut, figure englobant toutes les grandes enseignes — n’est donc pas seulement un envahisseur du foyer moderne : il est l’un des agents majeurs de l’empoisonnement général, esthétique, corporel et spirituel. En diffusant des objets sans nécessité, des ersatz de style et de vie, il prépare un monde d’hommes standardisés: « Car ce faisant Monsieur Boucicaut a eu pour seul but de faire affluer au fond de ses caisses le plus grand nombre possible de deniers. Peu lui importe si par sa faute un tel afflux de laideur s’est répandu sur le monde, que l’on peut dire de l’homme à présent que de l’heure de sa naissance à l’heure de sa mort il a macéré dans la laideur. Boucicaut, par l’importance de son industrie, demeurera toujours le grand envahisseur du foyer et l’empoisonneur de la santé esthétique du public. »
Artaud-selfie ? Ou la critique qui refuse de lire
Je pressens que le titre choisi pour cet article — ainsi que la petite vignette — risque de froisser certains et d’en amener d’autres à s’interroger : quel rapport entre Artaud et les Galeries Lafayette ? On me reprochera alors de m’amuser à inventer ici un titre accrocheur, là une formule, et de prélever quelques phrases hors de leur contexte pour faire dire à Artaud tout et n’importe quoi. De là pourront naître des procès d’intention, émanant de personnes qui ‘‘n’avancent pas masquées’’, mais sans jamais désigner clairement celles qu’elles prétendent critiquer: « Artaud est devenu un « logo », une marque de fabrique offrant à tout un chacun l’illusion des narcissismes tout à la fois les plus enfantins et les plus éculés. « Le « Artaud-selfie ». Phénomène d’époque sans aucun doute. Attendons des jours meilleurs.», ou encore — comme j’ai pu le lire ailleurs — : « Pourquoi les débiles d’ActuaLitté s’occupent comme ça d’Artaud ? Ça récupère en douce pour le fun ? »
La problématique étant d’ordre philosophique, il ne s’agit nullement ici d’ériger un tribunal des opinions : chacun demeure libre d’exprimer le jugement qu’il estime pertinent. Ce que je trouve, en revanche, profondément regrettable, c’est que ces mots viennent de personnes qui disposent des connaissances, du talent et de la légitimité nécessaires sur Antonin Artaud pour formuler de véritables mises en question de fond, mais qui préfèrent s’en tenir à des objections de forme — rapides, faciles et, au fond, creuses.
Si je me permets cette parenthèse, ce n’est pas pour répondre à ces attaques, mais parce que ce type de critique gratuite a des conséquences très concrètes sur la diffusion même de l’œuvre et de la pensée d’Artaud. On l’a vu notamment avec les quatre nouveaux articles d’Artaud, retrouvés en 2009 à Cuba, dont l’importance sur le fond est objectivement considérable. Lorsqu’une personne disposant d’un réel poids dans le champ artaudien minimise cette découverte en reléguant ces textes sous l’étiquette de ‘‘curiosa’’, elle ne se contente pas d’exprimer une opinion personnelle : elle installe une défiance durable et contribue, de fait, à renforcer la frilosité des maisons d’édition, de plus en plus réticentes à publier ces textes nouvellement découverts. Plutôt que ce geste de disqualification, il aurait été plus juste — et surtout plus utile — d’argumenter, d’expliquer précisément, exemples à l’appui, pourquoi ces textes devraient être considérés comme secondaires.
Je suis conscient qu’aujourd’hui, lorsqu’on n’est ni auteur maison ni non chroniqueur-philosophe gravitant dans l’orbite Lagardère-Bolloré — CNews ou les éditions Fayard, par exemple —, quelles que soient les heures investies dans un projet, il faut redoubler d’efforts, de persévérance et d’insistance pour attirer l’attention et faire reconnaître sa parole. Mais, qu’on adhère ou non à ma démarche, une chose au moins devrait s’imposer : ne pas saboter les textes ni la pensée d’Artaud.
Je tiens donc à préciser un point essentiel : j’emploie la forme de manière délibérée, avec les moyens dont je dispose, afin de capter l’attention et de rendre mes idées plus lisibles, plus directes, plus accessibles. Qu’elle ne plaise pas à tous est parfaitement admissible ; s’y arrêter exclusivement me semble, en revanche, profondément réducteur.
Plutôt que de multiplier les réactions réflexes, pourquoi ne pas consentir à l’effort d’une lecture réelle des textes d’Artaud retrouvés à Cuba et, au lieu de lancer des formules telles que ‘‘vertige bien malsain’’ à propos de mon travail, pourquoi ne pas chercher à saisir le fond de mes intentions ? Et s’il doit y avoir critique, même sévère, qu’elle porte enfin sur le fond, et non sur une plaisanterie ou une parenthèse d’autodérision destinée à créer un point d’accroche. Si je joue avec la forme — comme Artaud le fait lui-même, avec sans doute plus de talent —, pourquoi s’y arrêter plutôt que d’interroger ce qui est visé : le sens, la pensée, la charge ?
Pour ne pas tourner autour du pot, et bien que cela ne me fasse aucun plaisir d’écrire ces lignes — d’autant plus que, lorsque j’étais plus jeune, Mme Florence de Mèredieu faisait partie de mes auteurs de référence sur Artaud —, il me semble nécessaire d’aller au fond des choses. Dans la mesure où l’ouvrage L’Affaire Artaud, publié chez Fayard, a porté une atteinte discutable à la mémoire de Mme Paule Thévenin, celle-ci doit aujourd’hui être rétablie avec équité.
Je trouve ainsi injuste — et peu sérieux —, à titre de simple exemple, que, d’une part, Mme Florence de Mèredieu écrive dans C’était Antonin Artaud que Federico García Lorca aurait été fusillé par les républicains espagnols (p.570), et que, d’autre part, dans L’Affaire Artaud, elle consacre un paragraphe entier à reprocher à Paule Thévenin d’avoir retranscrit ‘‘pourjoi’’ au lieu de ‘‘pourquoi’’, ou encore, page 186, à lui reprocher un choix de mise en forme alors même que la page de son propre ouvrage se dédouble.
Je m’en tiens volontairement à ces deux exemples et n’en évoquerai pas d’autres. Même si je n’adhère pas à l’ensemble des analyses et ouvrages proposées par Mme de Mèredieu, il faut reconnaître que C’était Antonin Artaud, malgré certaines erreurs, demeure un travail biographique de grande qualité, remarquable par son effort de regroupement de sources parfois difficiles d’accès, et qui ne mérite ni procès d’intention ni attaque globale.
Moi le premier, nous avons tous commis des erreurs de frappe et des maladresses dans nos travaux et, dès lors que nous ne sommes pas des machines, c’est parfaitement normal — y compris Paule Thévenin, qui, au regard de la difficulté de sa tâche, a objectivement accompli un travail d’une grande rigueur. Ce qui devient problématique, en revanche, c’est de s’être largement appuyé sur ses découvertes, ainsi que sur celles des Virmaux, pour ensuite chercher à minimiser, voire à discréditer, sa contribution au profit de logiques personnelles et de règlements de comptes et peut être même au service d’intérêts qui dépassent largement la seule question d’Artaud.
En ce qui concerne, par exemple, la retranscription du fameux 26ᵉ tome, à titre personnel — pour des raisons que j’expliquerai ailleurs —, j’aurais fait, au début du texte, exactement les mêmes choix que Paule Thévenin et, comme elle, je les aurais justifiés et explicités en notes.
Si je suis allergique aux manœuvres de disqualification par cherry-picking, je le suis encore davantage au culte qui s’est développé autour des manuscrits, lorsqu’on a décidé de les ériger en œuvres d’art afin d’en accroître la valeur marchande. Je ne dis pas qu’ils sont dépourvus de valeur ; mais, à force de se focaliser sur cet aspect, de sacraliser les cahiers de Rodez et de Paris et de leur conférer une dimension presque divinisée, on passe à côté de l’essentiel : le fond même de la pensée d’Artaud.
Peut-être que ces objets et ces textes provoquent, chez leurs défenseurs, des bouleversements intimes profonds, une fascination quasi hypnotique, presque dévotionnelle ; dans ce cas, cela aurait un sens — mais j’en doute très fortement.
Et pourquoi parler de cette affaire aujourd’hui ? Parce que Noël approche. Et qui, il y a dix ans, discutait avec les éditions Gallimard d’une éventuelle publication des textes d’Artaud retrouvés à Cuba ? Bernard Noël, un ami d’enfance de Paule Thévenin. Et vous êtes-vous demandé qui, il y a dix ans très précisément, avait intérêt à minimiser les articles de Cuba — et pourquoi ?
En toute honnêteté, je ne pense pas que Mme de Mèredieu, même si elle a contribué à la renommée d’Artaud et à l’augmentation de sa valeur marchande, fasse partie de ceux qui ont profité de cette renommée pour se faire une fortune. Mais son commentaire sur le site d’ActuaLitté n’a toujours pas été corrigé. Et je ne pense pas qu’en 2025, après toutes les preuves désormais disponibles, on puisse encore affirmer, sans le moindre argument, que nous ne disposerions pas de manuscrits de ces textes en français, que l’on ne saurait rien de ces textes, et que tout cela ne relèverait que d’un amas de supputations, d’une affaire qui tournerait en rond.

Los Indios y la metafisica, Grafos, source Laurine Rousselet
Maintenant que l’abcès est crevé, revenons donc au titre : Quand Artaud lançait une croisade contre les Galeries Lafayette. On pourrait y voir, une simple accroche un peu malicieuse, un clin d’œil destiné à actualiser le propos. Eh bien non — du moins pas dans ce cas précis : dans la dernière phrase du Grand Magasin empoisonneur, Artaud cite bel et bien les Galeries Lafayette. « Boucicaut est en l’espèce un symbole et signifie aussi bien le directeur du Bon Marché que celui du Louvre, des Galeries Lafayette ou de telle autre maison de perdition. »
Voilà-voilou : la revue Écho Antonin Artaud vous souhaite un joyeux Noël et, juste pour le fun — Artaud-selfie oblige —, vous glisse sous le sapin cette image, pas très catholique, inutile, donc indispensable.