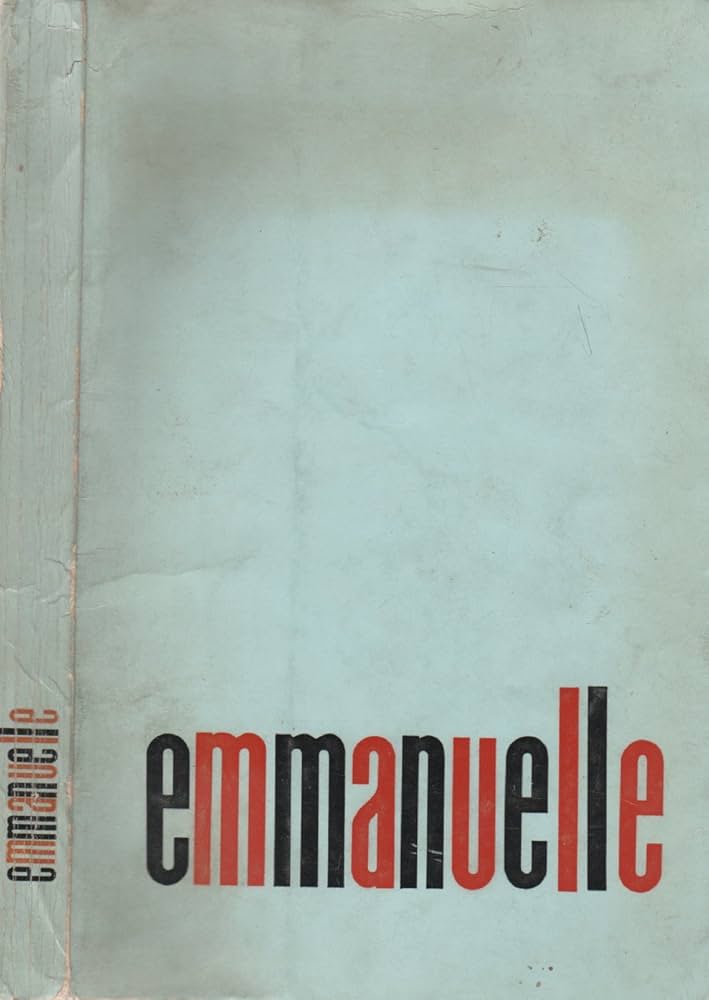
Avant d’entrer dans le vif du sujet, rendons hommage à Christine Boisson, disparue à Paris le 21 octobre 2024, à l’âge de 68 ans, des suites d’une maladie pulmonaire. Révélée à seize ans dans le nanar érotique Emmanuelle (1974) — avec l’autorisation de ses parents, son père étant militaire —, elle refusa pourtant de se laisser enfermer dans l’image de l’adolescente scandaleuse et choisit une carrière exigeante. Elle collabora avec des cinéastes aussi différents qu’Antonioni, Robbe-Grillet, Assayas, Claude Lelouch, Garrel ou encore Maïwenn. Derrière les fragilités souvent relayées par la presse — dépendances, relation difficile avec avec une mère abusive voir incestueuse, tentative de suicide en 2010 —, se révélait une femme passionnée de lecture, capable d’incarner avec intensité le Manifeste du surréalisme dans Breton par Breton (1991).
Sa disparition invite, aussi surprenant que cela puisse paraître, à revisiter les résonances inattendues entre Antonin Artaud et le mythe d’Emmanuelle, né du roman d’Emmanuelle Arsan.
Le roman Emmanuelle de Marayat Adriane (Emmanuelle Arsan)

Marayat Adriane, née en 1932 à Bangkok dans une famille de la haute société siamoise, épouse à seize ans le diplomate français Louis-Jacques Rollet. En 1959, elle publie anonymement Emmanuelle, un roman largement inspiré de sa propre vie qui raconte l’éveil sexuel d’une jeune femme mariée. À une époque où un tel ouvrage pouvait valoir un an de prison, Emmanuelle fut perçu comme un livre érotique intellectuel et circula clandestinement, vendu sous le manteau dans de petites librairies.
Le premier lien direct et évident avec Artaud apparaît dès l’ouverture du roman, qui s’ouvre sur une citation : « Nous ne sommes pas encore au monde. Il n’y a pas encore de monde. Les choses ne sont pas faites. La raison d’être n’est pas trouvée. » Marayat Adriane reprend ici une phrase prononcée par Artaud lors de sa conférence du 13 janvier 1947 au Vieux-Colombier, alors même que ce texte n’était pas encore publié en 1959.
Il faut toutefois préciser que cette phrase n’est pas entièrement d’Artaud, mais une réinterprétation de Rimbaud : « La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. » Comment Marayat a-t-elle pu y avoir accès ? La source la plus probable est l’hommage rendu par André Gide dans le numéro spécial de la revue 84, paru en mars 1948 juste après la mort d’Artaud, que Marayat possédait sans doute. Ce numéro contenait également un témoignage d’Alain Cuny, ami d’Artaud… et futur interprète du film Emmanuelle.
Utiliser une telle référence à cette époque ou Artaud était encore peu connu témoigne de l’étendue de la culture de Marayat Adriane. Elle fut sans doute l’une des premières, peut-être même la toute première, à placer une citation d’Artaud en exergue d’une œuvre littéraire avant les années 1960. Éduquée dans un pensionnat en Suisse puis en Angleterre, polyglotte, passionnée de philosophie, de mathématiques et de physique, elle écrivait bien au-delà du simple roman érotique. Emmanuelle cite Nietzsche, Ovide, et s’inspire des journaux d’Anaïs Nin, où Artaud est également présent. On y trouve des passages à la portée philosophique évidente, parfois proches de la pensée d’Artaud, tel celui-ci : « Ce qui est beau, c’est de dire non à la tentation qui nous immobilise, qui vous attache ou qui vous limite. Et de dire oui, toujours oui, si lasse que vous soyez, à celle qui vous multiplie et vous pousse en avant et vous force à faire plus qu’il n’est suffisant ou nécessaire, et plus que les autres se contentent de faire. Ce qui est beau c’est de trouver chaque jour un sujet d’étonnement nouveau, une raison d’émerveillement, un prétexte à l’effort et à victoire sur la tentation de l’acquis et sur l’assouvissement et la tristesse de l’âge. Ce qui est beau c’est, inlassablement, de changer. Car tout changement est un progrès, toute permanence une tombe. Contentement et résignation ne sont qu’un seul et même désespoir, et celui qui s’arrête et renonce à devenir autre chose à déjà opté pour la mort. »

Si l’on y réfléchit, de nombreux points rapprochent Marayat d’Artaud. Comme lui, elle a beaucoup souffert très jeune d’une maladie neurologique : dès l’âge de vingt ans, elle est diagnostiquée d’une sclérose en plaques, dont elle souffrira jusqu’à sa mort en 2005. Comme lui encore, elle fut comédienne : en 1966, elle incarne le rôle de Mady dans La Canonnière du Yang-Tsé, aux côtés de Richard Attenborough, Steve McQueen et Candice Bergen, et participe également à un film qu’elle réalise elle-même. Enfin, tout comme Artaud avait publié Lettre adressée au pape, Marayat fit paraître en 1968 une Épître à Paul VI.
Il est vrai que l’on associe souvent Artaud à l’image d’un poète horrifié par la sexualité. Cette représentation, bien qu’elle contienne une part de vérité, reste incomplète. La relation à la sexualité chez Artaud est plus complexe. S’il dénonçait l’assouvissement comme une perte du désir vital, il fut aussi un véritable écrivain du désir. Ses textes — qu’il s’agisse de sa traduction du Moine de Lewis, de ses critiques de Tricheurs de Steve Passeur ou encore d’Héliogabale — abordent la sexualité comme une force politique et libératrice.
Le nanar érotique de 1974

Il y a cinquante ans, en 1974, le roman Emmanuelle, jusque-là réservé à un cercle restreint d’intellectuels, devient par un étrange concours de circonstances un phénomène mondial. Pour comprendre, il faut rappeler le contexte : avant les années 1970, il était presque impossible de voir des scènes érotiques au cinéma en France. Aux États-Unis, des films comme Gorge profonde sortent en salles dès 1972, mais ils ne franchissent pas les frontières françaises, encore soumises à une censure puritaine. En France, la sexualité n’apparaît alors qu’en filigrane, intégrée à des films « intellectuels » tels que Le Dernier Tango à Paris de Bertolucci.
C’est dans ce climat qu’apparaît Yves Rousset-Rouard, jeune publicitaire de 32 ans (et oncle de Christian Clavier). Plutôt conservateur — il deviendra plus tard maire de Ménerbes, affilié à l’UMP —, sans moyens financiers ni attaches avec le milieu de l’érotisme ou des intellectuels, il observe le succès du Dernier Tango et la vogue américaine des films sexuels. De là lui vient une idée : produire un film « intello-érotique », peu coûteux, capable de provoquer le scandale et d’attirer l’attention.
Un de ses amis « intellectuels », Guy Sorman — aujourd’hui considéré comme l’un des fondateurs du néo-libéralisme — lui suggère d’adapter le roman Emmanuelle d’Emmanuelle Arsan. Yves Rousset-Rouard n’ayant pas les moyens de faire appel à un réalisateur confirmé, raisonne en publicitaire : « Un film intello, c’est juste de belles images. Pourquoi ne pas le confier à un photographe ? Après tout, ils rêvent tous de devenir cinéaste un jour. » Il pense d’abord à David Hamilton, mais celui-ci refuse, jugeant l’héroïne trop âgée. Rousset-Rouard se tourne alors vers Just Jaeckin, photographe pour Elle, Marie Claire et Vogue, qui a immortalisé Barbara, Serge Gainsbourg ou Brigitte Bardot.
Jaeckin hésite : il ne veut pas être catalogué comme réalisateur de films érotiques. Rousset-Rouard tente de le convaincre qu’il s’agit avant tout d’une œuvre « intellectuelle », où l’érotisme n’est qu’un prétexte littéraire. Pour crédibiliser le projet, il engage Jean-Louis Richard, scénariste de François Truffaut, pour adapter le roman. Finalement, séduit par l’occasion de diversifier sa carrière, Jaeckin accepte.
Si le film avait suivi le roman, l’héroïne aurait dû être asiatique. Les auditions commencent en ce sens, jusqu’au jour où Sylvia Kristel, jeune mannequin néerlandaise, se trompe de porte et entre par hasard dans la salle du casting. À sa vue, Jaeckin, plus sensible à l’image qu’au scénario, tranche aussitôt : « C’est elle que je veux ! » Kristel accepte, sans mesurer l’ampleur du projet, qu’on lui présente comme une œuvre esthétique parsemée de quelques scènes érotiques. Restait à trouver une vedette capable d’attirer le grand public, à l’image de Brando dans Le Dernier Tango à Paris. Rousset-Rouard pense d’abord à Michel Piccoli, auréolé du scandale de La Grande Bouffe l’année précédente. Piccoli décline. Il se tourne alors vers Alain Cuny, ami d’Artaud, qui accepte… mais exige que son nom ne figure pas au générique.
C’est ici que surgit le deuxième lien entre Artaud et le mythe Emmanuelle. Alain Cuny (1908-1994), élève de Charles Dullin, fut un ami proche d’Antonin Artaud, qui allait jusqu’à lui dresser des horoscopes en 1936. Alors, quand on sait qu’Alain Cuny a fini par jouer dans Emmanuelle, film érotique par excellence, il est difficile de ne pas sourire en relisant cette lettre qu’Artaud lui adresse depuis Rodez, le 29 mars 1944 : « Pourtant mes idées sont très simples. Elles sont qu’il faut être chaste, absolument et exclusivement chaste, et qu’une humanité sexuée ne doit pas se reproduire parce que la reproduction sexuelle est un péché, tout comme l’usage de la sexualité est un péché, et qu’un monde axé sur la sexualité et bâti sur elle doit retourner à la … du néant… (Vanina) comprendra, car comme moi elle a horreur du péché de la chair, et vous aussi, Cuny, vous en avez horreur. Décidez-vous enfin à réaliser votre véritable destin. »
Chronique d’un tournage ridiculement désastreux
Même si l’on garde aujourd’hui l’image d’un film culte, rien ne laissait présager un tel destin. Une chose est certaine : ni les acteurs ni les techniciens n’avaient accepté ce projet pour l’argent — il n’y en avait pas —, ni même vraiment pour lancer leur carrière.
Sylvia Kristel, par exemple, ne toucha que 18 000 francs pour ce premier volet — l’équivalent d’à peine une trentaine d’euros aujourd’hui. Les véritables motivations de l’équipe tenaient surtout dans l’attrait d’un voyage en Thaïlande offert par la production et dans la curiosité de participer à une aventure cinématographique.
Mais côté organisation, c’était le chaos. Aux autorités locales, on avait déclaré qu’il s’agissait d’un documentaire sur la Thaïlande. En réalité, les scènes étaient tournées dans l’improvisation, souvent clandestinement. Le budget pellicule ne permettait qu’une seule prise, deux tout au plus. Kristel, qui n’avait pas appris son texte, se perdait dans ses dialogues et parlait avec un fort accent. Mal à l’aise — son éducation religieuse pesant encore sur elle —, elle éclatait souvent de rire pendant les scènes érotiques. Une séquence prévoyait qu’elle monte à cheval, mais elle n’avait jamais appris à en faire. Un jour, les autorités thaïlandaises surprirent l’équipe en train de filmer une scène trop audacieuse et les conduisirent directement au poste.
Lorsque Yves Rousset-Rouard visionna les premiers rushes, la déception fut immense. Le film lui semblait lent, trop esthétisant, parfois même ennuyeux. Publicitaire de métier, il avait produit Emmanuelle pour marquer les esprits, pas pour composer un album d’images contemplatives. Rapidement, des tensions s’installèrent entre lui et Just Jaeckin, le réalisateur-photographe, chacun abordant le film dans un esprit radicalement différent.
Un soir, lors d’une sortie dans les boîtes de nuit de Bangkok, Yves demande à Just Jaeckin de filmer des jeunes filles mineures dansant à moitié nues dans le club. Jaeckin, choqué par la vulgarité de la scène proposée et troublé par le jeune âge apparent des danseuses, refusa catégoriquement de les filmer. Yves, furieux de ce refus, saisit alors lui-même la caméra et convainquit l’une de ces filles, contre quelques billets, d’exécuter la scène qu’il avait en tête ou une fille fume avec son sexe.
Yves, publicitaire de métier, cherche délibérément à provoquer pour créer un scandale autour de son film, peu importe le coût humain ou éthique. Son objectif est d’attirer l’attention, en tentant de reproduire l’effet choc de la célèbre scène du beurre dans Le Dernier Tango à Paris. Il est essentiel de rappeler que cette scène de Bernardo Bertolucci relève d’un acte de violence : un viol filmé, tourné sans le consentement de l’actrice Maria Schneider. Bertolucci et Marlon Brando l’avaient volontairement tenue à l’écart de la préparation, la soumettant à une humiliation et à une exploitation inacceptables sous couvert de « réalisme artistique ».
Certains diront que c’était une autre époque, avec d’autres mœurs. Pourtant, même à ce moment-là, il demeure incompréhensible que la société ait pu tolérer — voire justifier — de tels abus, sous prétexte de génie créatif ou de liberté artistique. Cette complaisance explique en partie pourquoi des comportements comme ceux de Polanski ou de Jacques Doillon ont longtemps été couverts, alors même qu’ils relevaient de l’exploitation et de la domination.
Une fois le film terminé, tous ceux impliqués dans la production regrettaient d’avoir participé, le considérant eux-mêmes comme un « énorme navet. « Cerise sur le gâteau, le film a été bloqué par les membres du comité de censure et interdit de sortie.
De nanar promis à l’oubli au succès planétaire
Tout bascule avec la mort du président Pompidou, le 2 avril 1974, et l’élection de Valéry Giscard d’Estaing, qui avait promis d’assouplir la censure cinématographique. Dans ce nouveau climat, Emmanuelle devient le premier film à bénéficier de cette ouverture. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, un an plus tôt, en mars 1973, France Culture avait enfin diffusé Pour en finir avec le jugement de Dieu d’Antonin Artaud, longtemps censuré.
Contre toute attente, Emmanuelle connaît un succès phénoménal. Depuis sa sortie, il a attiré près de 350 millions de spectateurs. À Paris, il reste à l’affiche du cinéma Triomphe sur les Champs-Élysées pendant treize ans. Rapidement, il devient une véritable attraction touristique : des bus entiers de visiteurs étrangers — notamment japonais — sont organisés pour assister aux projections.
Le film arrive au moment où la société se transforme : la pilule contraceptive permet désormais aux femmes de dissocier sexualité et maternité, et l’adultère reste encore tabou. L’histoire d’une femme mariée en quête de plaisir ne séduit donc pas seulement les hommes, mais aussi les femmes, curieuses d’un récit centré sur la redécouverte du désir féminin. On n’allait pas voir Emmanuelle dans des salles clandestines, mais dans de vraies salles de cinéma, avec un mélange d’effet de curiosité, de scandale et de conversations mondaines. Le film s’impose comme l’image des « mœurs libérées à la française », notamment pour les Américains.
Faut-il pour autant dire qu’Emmanuelle est un film qui met en valeur les femmes ? Non. Certaines scènes, inacceptables aujourd’hui, banalisent des représentations problématiques. Mais il est vrai que le film aborde, parfois frontalement, des thèmes encore tabous à l’époque : la masturbation féminine à l’écran, les relations homosexuelles entre femmes, l’adultère féminin. Il a ainsi contribué à ouvrir des débats qui, jusque-là, restaient tus.
Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’autrice du roman a toujours vécu l’adaptation comme une trahison de son œuvre. Comme Colette Thomas, Marayat Adriane était une femme libre, utilisant son corps et son esprit de manière indépendante, en dehors des cadres imposés par la pensée masculine. Le film, conçu par des hommes, fut à ses yeux non seulement une mauvaise interprétation de son livre, mais aussi une négation de sa singularité. Elle l’a d’ailleurs toujours renié, allant même jusqu’à tenter de produire un second film, plus fidèle au roman.
Pendant ce temps, Yves Rousset-Rouard capitalise sur ce succès : il devient le producteur des Bronzés puis, en 1993, député UDF du Vaucluse. Pour mémoire, l’Union pour la démocratie française (UDF), fondée en 1978, était un parti de centre droit d’inspiration démocrate-chrétienne et libérale, créé pour soutenir Giscard. Comme l’a résumé Jean-Pierre Prével ancien directeur de la photo à Ouest-France : « Yves voulait faire un film à succès, gagner de l’argent, devenir connu… il a réussi. »
Quant à Sylvia Kristel, de nature très timide et encore plus fragile durant le tournage, elle devint pourtant une star planétaire. Mais ce succès fulgurant, loin de l’épanouir, la brisa : le film qui l’avait révélée au monde fut aussi celui qui l’entraîna dans la drogue et l’alcool, marquant le début d’une descente douloureuse.
Le mythe d’Emmanuelle
Emmanuelle est devenu un mythe moderne — et les mythes naissent toujours par accident. Un réalisateur débutant, une actrice inconnue, un producteur opportuniste : c’est précisément parce que le film n’était pas conçu comme une œuvre « majeure » qu’il est devenu culte. Peu importe si, aujourd’hui, on le qualifie de « nanar érotique » : il a répondu aux besoins de son époque et a servi de passerelle. Grâce à lui, certains spectateurs ont découvert le roman d’Emmanuelle Arsan, appris l’existence d’Artaud et rencontré des idées nouvelles.
Surf sur cette vague, le magazine Emmanuelle publia même des articles étonnamment progressistes pour l’époque : sur l’homosexualité féminine, le racisme social, la révolution sexuelle, mais aussi sur les violences sexuelles dans les prisons américaines, le racisme sexuel entre Blancs et Noirs, et même la transidentité. Beaucoup de lecteurs, venus d’abord pour les photos de charme, s’ouvraient ainsi, parfois malgré eux, à des débats de société inédits.
Ainsi, même si l’on n’aime pas le film Emmanuelle, il reste difficile d’échapper à la fascination qu’exerce encore aujourd’hui son mythe.
